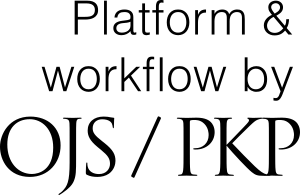Archives
-
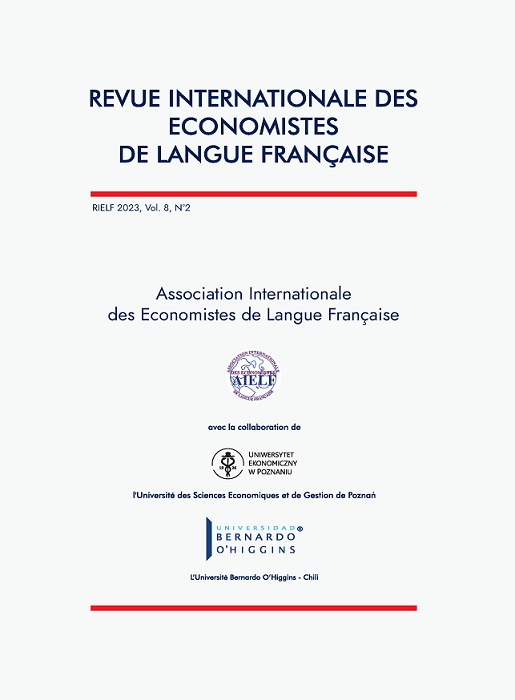
Vol. 8 No. 2 (2023)
Nous présentons à nos lecteurs le numéro 2/2023 de la RIELF, qui est composé de huit articles rédigés par une quinzaine d’auteurs issus de pays tels que : le Burkina Faso, le Mali, la Pologne, le Sénégal et le Togo. Les deux premiers articles concernent les enjeux de santé mondiale. Les six articles restants font référence à l’Afrique : 49 pays africains, pays d’Afrique subsaharienne, pays UEMOA, et directement au Burkina Faso, au Sénégal et au Togo.
Idrissa Yaya DIANDY dans l’article Analyse exploratoire spatiale des effets sanitaires et économiques de la COVID-19 à partir de données mondialeseffectue une analyse des effets sanitaires et économiques de la pandémie de COVID-19. L’échantillon est composé de 132 pays et la méthodologie se fonde sur l’analyse exploratoire des données spatiales. Le calcul de l’output gap par la méthode de Hodrick-Prescott a permis de ressortir les manifestations économiques de la crise sanitaire, à travers les écarts de production pour l’année 2020. La variable sanitaire, quant à elle, est mesurée par le taux d’incidence de la COVID-19 et la mortalité. Les résultats des estimations ont permis de valider l’hypothèse d’autocorrélation spatiale aussi bien pour la variable sanitaire que pour la variable économique.
L’examen du diagramme de Moran confirme le schéma d’association spatiale local positif, c’est-à-dire l’existence à la fois de similitudes entre pays voisins dans la manifestation de la pandémie et d’hétérogénéité spatiale entre les groupes de pays. De manière plus précise, les résultats montrent l’existence de clusters avec de faibles niveaux d’incidence de la COVID-19 en Afrique et en Asie, comparativement à l’Europe et à l’Amérique du Nord. De plus, si les pays à revenu élevé ont généralement été davantage touchés sur le plan sanitaire, ils ont toutefois développé une plus grande résilience économique. (Krzysztof Malaga).
-
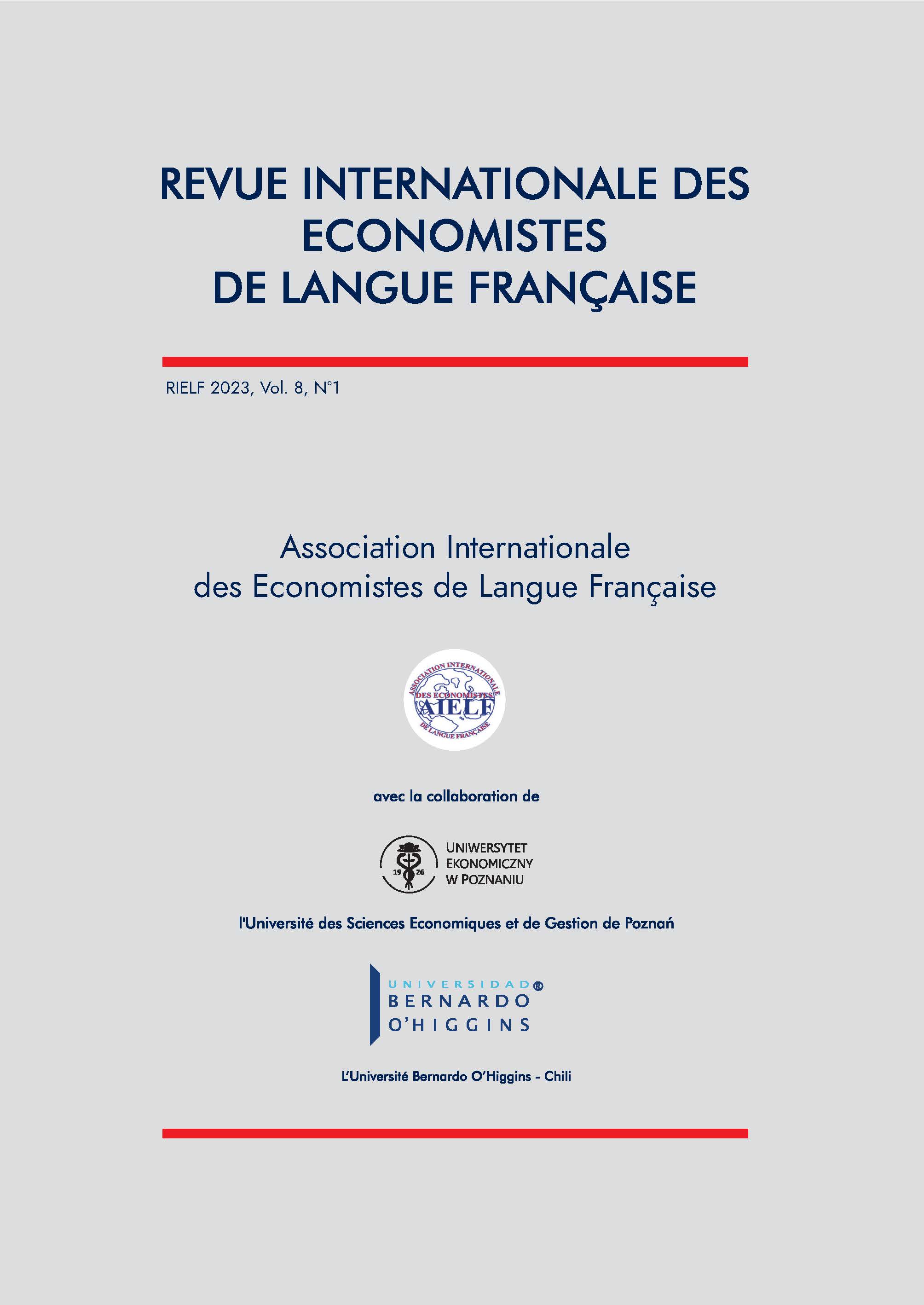
Vol. 8 No. 1 (2023)
Le numéro 1/2023 de la RIELF, que nous avons le plaisir de présenter aux lecteurs, a été édité par rédacteur invité Dr. Claudio RUFF ESCOBAR, en collaboration avec le Dr. Francisco OCARANZA BOSIO de l’Université Bernardo O'Higgins de Santiago du Chili. Il se compose de 12 articles dont les onze premiers concernent l’Amérique du Sud. L’article douzième, quant à lui, fait référence à l’espace ouest-africain. (...) (Claudio Ruff Escobar et Krzysztof Malaga)
-
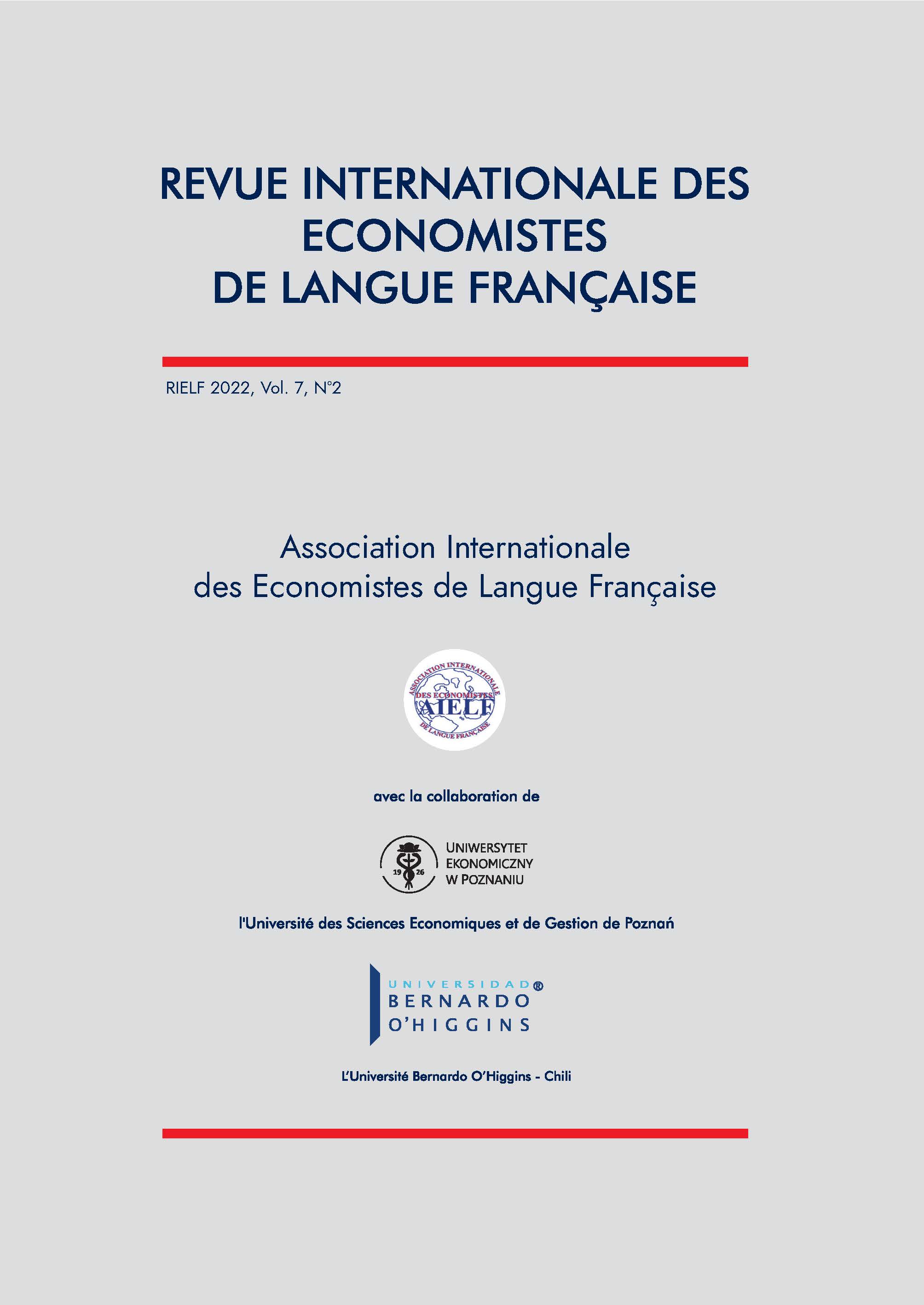
Vol. 7 No. 2 (2022)
Le numéro 2/2022 de la RIELF, que nous avons l’honneur de présenter à nos lecteurs, est composé de 11 articles. Le premier article concerne le Liban, le pays qui a accueilli en mai 2022 le 63e Congrès de l’AIELF. Les huit articles suivants couvrent l’Afrique, l’Afrique subsaharienne, l’UMEOA et des tels pays comme le Bénin, le Congo, le Sénégal ainsi que le Togo. Le dixième article concerne la Chine. Le onzième article est consacré aux pays d’Amérique du Sud. C’est une sorte d’introduction au numéro 1/2023 de la RIELF, qui sera entièrement consacré à ce continent. (...) (Krzysztof Malaga).
-
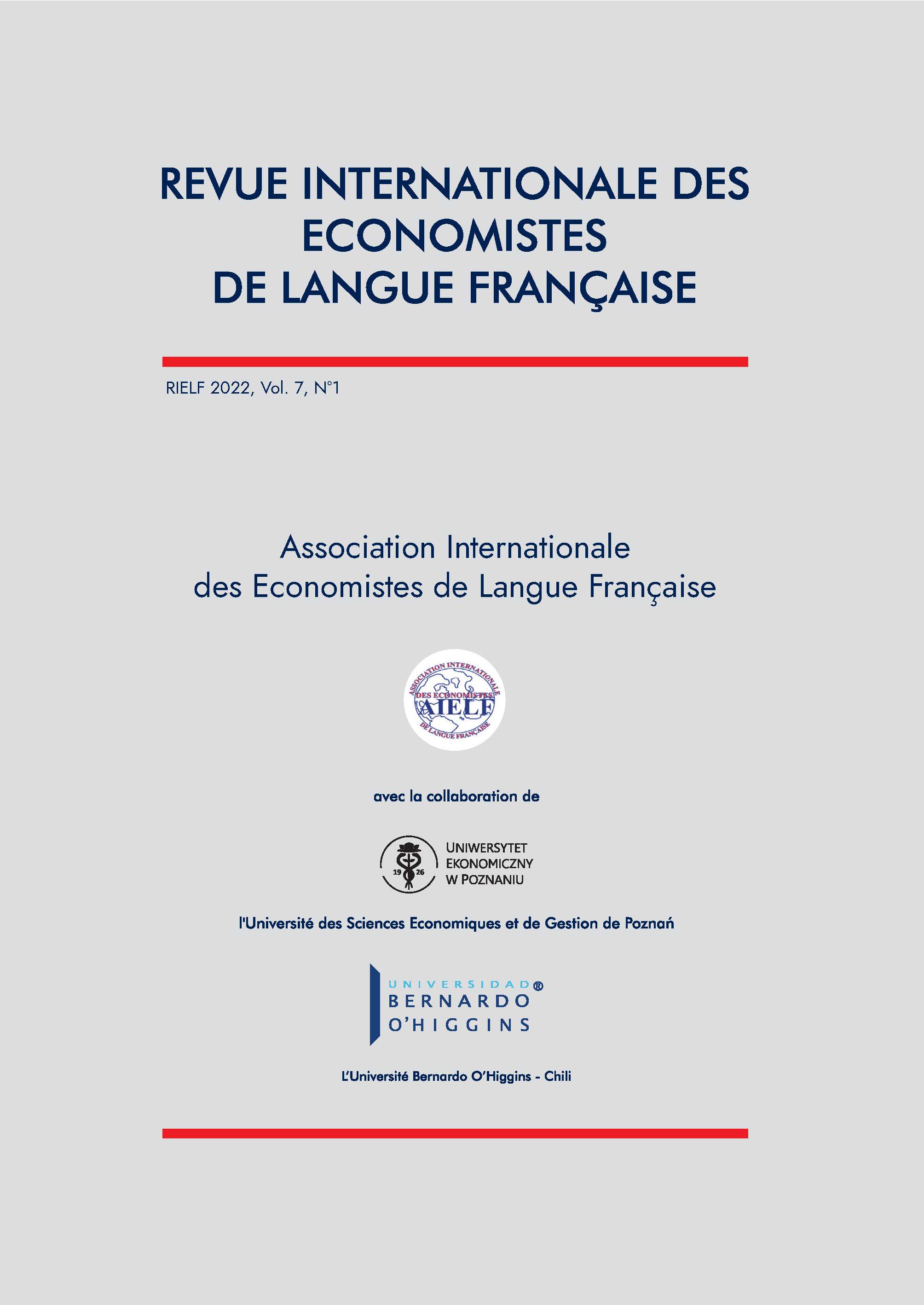
Vol. 7 No. 1 (2022)
Le numéro 1/2022 de la RIELF, que nous avons le plaisir de présenter à nos lecteurs, est composé de 13 articles et présentations de deux livres différents édités par des membres de l’AIELF. Les deux premiers articles sont écrits dans une perspective européenne, et les onze articles restants examinent la perspective africaine répartie en 45 pays africains, pays MENA, pays d’Afrique subsaharienne, pays de l’UEMOA ou pays individuels tels que le Cameroun, le Mali et le Togo. Le numéro 1/2022 commence par une étude d ’Alain REDSLOB, Une note en demi-teinte sur l’actualité du mercantilisme. Selon l’auteur, les thèmes scientifiques et les préconisations peuvent, parfois, rencontrer un écho au travers des siècles. Il en va ainsi du mercantilisme qui rencontre un regain d’actualité tant dans les cénacles universitaires que chez maints responsables de la politique économique. Quand on rapproche les contextes historiques, les formes revêtues et les idées propagées, force est d’admettre que les similitudes sont à nuancer (...) (Krzysztof Malaga).
-
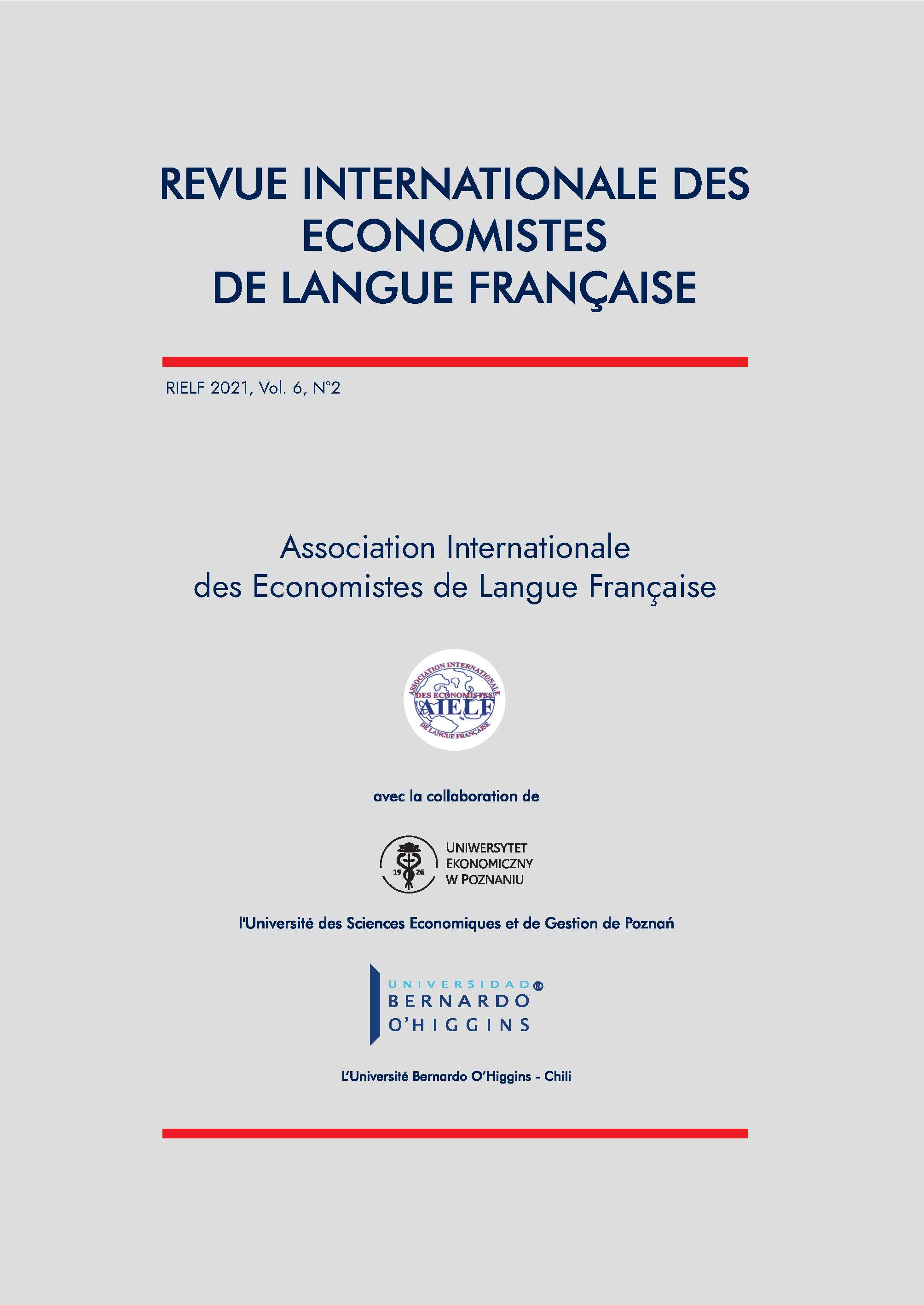
Vol. 6 No. 2 (2021)
C’est avec une réelle joie que nous remettons aux lecteurs le 11ème numéro de la RIELF. Numéro 2/2021 de la RIELF est unique à sa manière, car il traite entièrement des problèmes actuels et importants pour l’Afrique y compris la pandémie de COVID-19. Les articles qui y sont présentés concernent l’ensemble du continent africain, la Zone Franc, l’UEMOA, l’Afrique subsaharienne ou certains de ses pays. Courbe de Laffer de la relation entre la dette publique et la croissance en Afrique : importance de la qualité institutionnelle d’Idrys Fransmel OKOMBI concerne la question de l ’ existence d’un niveau d’endettement (point de retournement), au-delà duquel la dette publique commence à réduire la croissance économique. Toutefois, le seuil estimé varie selon les études et donne un aperçu incomplet du niveau d’endettement qui maximise la croissance. Selon l’auteur aucune étude n’a expliqué les causes de cette variation dans le contexte des pays d’Afrique. Cette étude vise à montrer que le seuil de la dette qui maximise la croissance dépend du niveau de la corruption, de la qualité de la démocratie et de l’efficacité du gouvernement. Pour y parvenir on a pris appui sur un échantillon de 45 pays africains, pour la période couvrant 1996–2018. Les résultats, obtenus par les méthodes d’estimations LSDVC et GMM-SYS suggèrent que les niveaux d ’ endettement public au-dessus desquels la croissance diminue, varient en fonction de la qualité des institutions. Plus précisément, lorsque la qualité institutionnelle est bonne, l’effet négatif de la dette publique sur la croissance se produit à des taux d’endettement plus élevés.
-
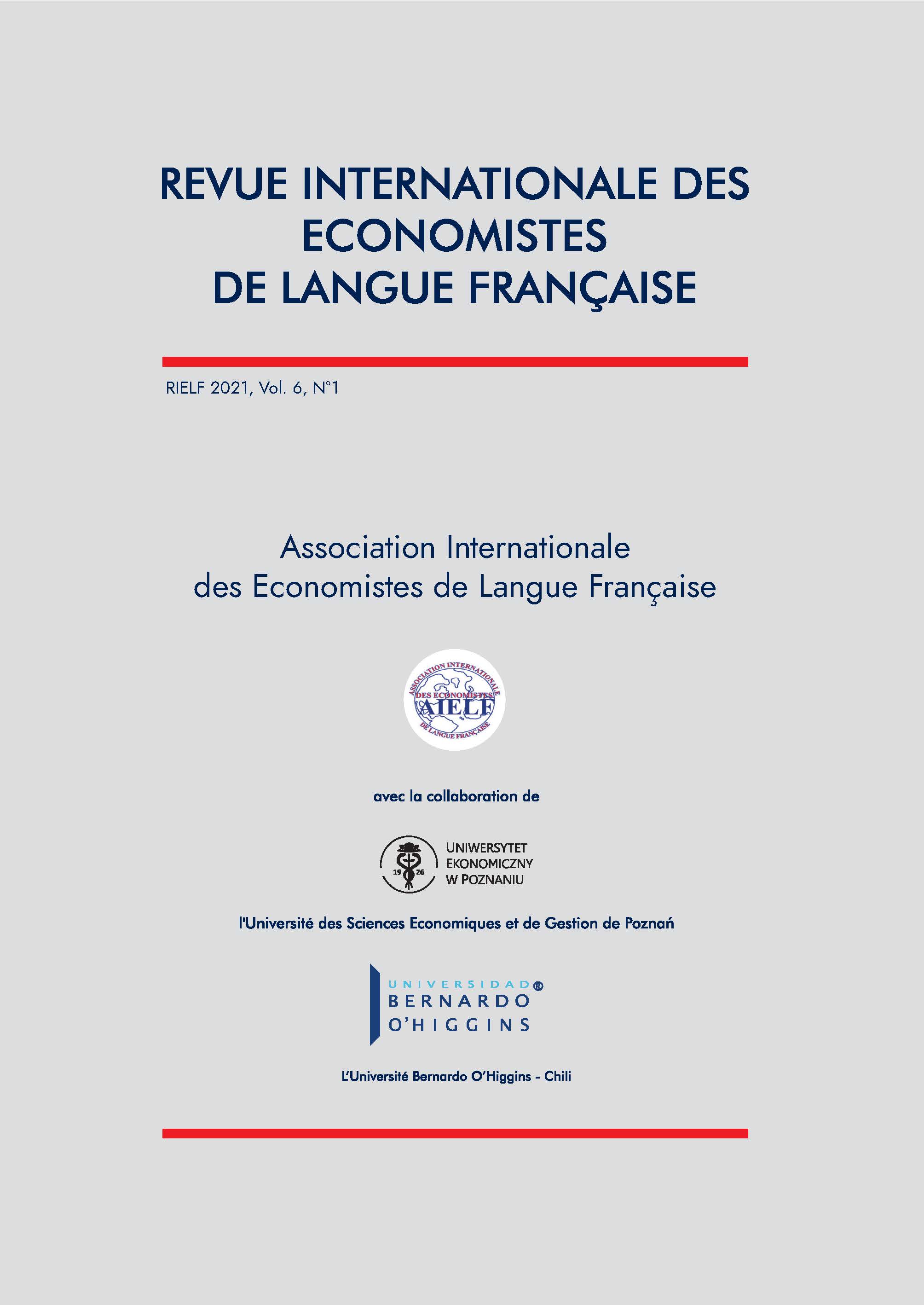
Vol. 6 No. 1 (2021)
Nous avons l’honneur de présenter aux lecteurs le 10ème numéro de la RIELF, qui se compose de deux parties conventionnellement distinguées. La première partie contient deux articles qui sont des tentatives intéressantes pour introduire la discussion sur des sujets généraux et très actuels. En revanche, la deuxième partie contient neuf articles qui se rapportent à d’importants problèmes économiques et sociaux discutés en relation avec l’Afrique subsaharienne ou certains de ses pays. Une théorie du développement économique de Bernard Lnadais est incontestablement une proposition très intéressante d’un nouveau contexte théorique dérivé du modèle MIE-Croissance élargi au développement. L’importance des cultures humaines et de leur transmission est soulignée, à côté de toutes les forces d’investissement plus classiques. Le développement est aussi considérablement freiné et sociologiquement restreint par l’existence des pressions s’exerçant sur les choix des individus. Cet article fait référence aux thèses fondamentales présentées dans deux ouvrages publiés en 2020.(...)(Krzysztof Malaga)
-
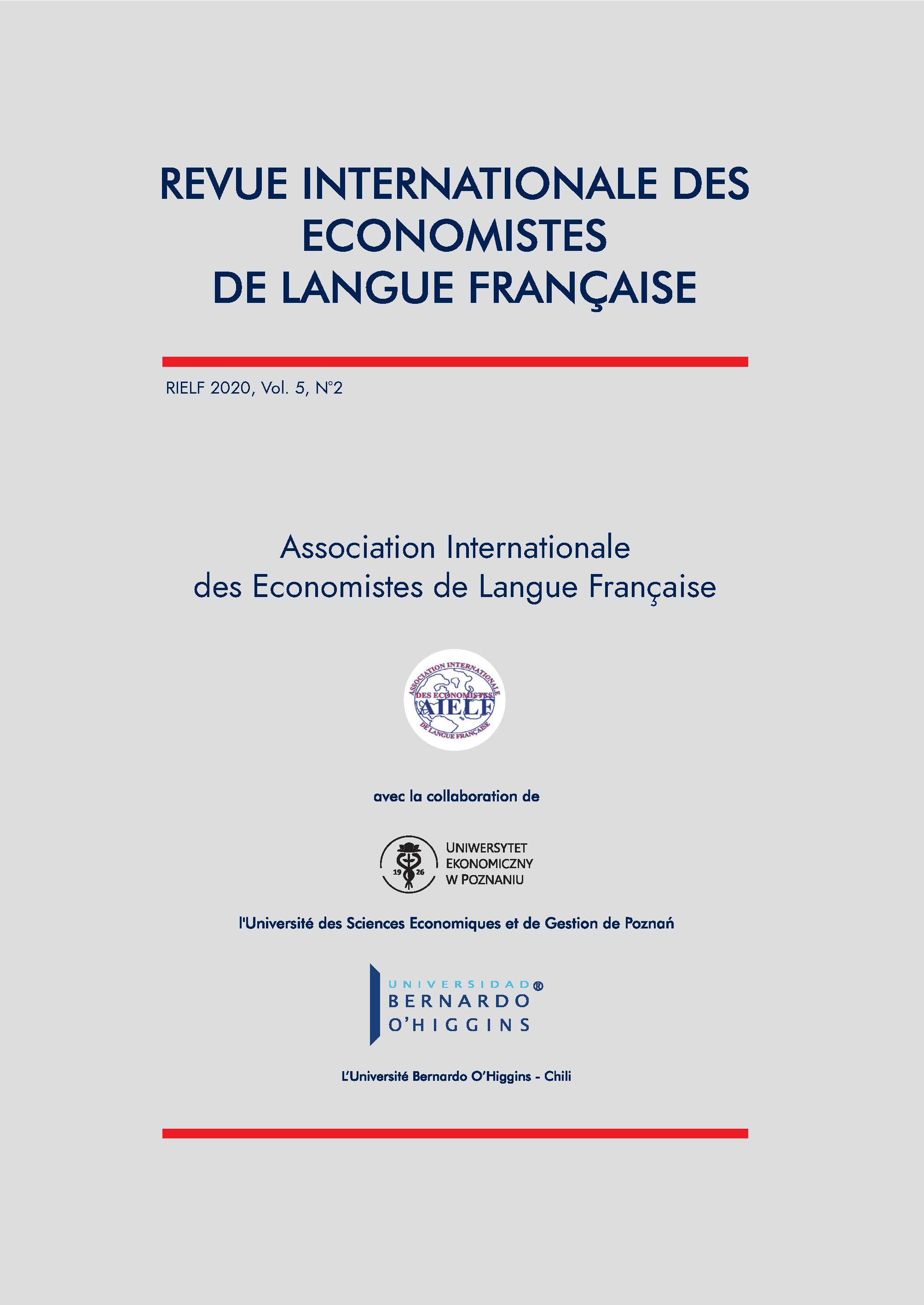
Vol. 5 No. 2 (2020)
Ce numéro 2 du volume 5 de la Revue Internationale des Economistes de Langue Française est un volume varia de 11 articles sur les domaines liés à la macroéconomie et à la microéconomie. Les 18 auteurs sont membres de l ’ Association internationale des économistes de langue française représentant 8 pays : Bénin, France, Liban, Maroc, Pologne, République du Congo, Sénégal et Togo.
-
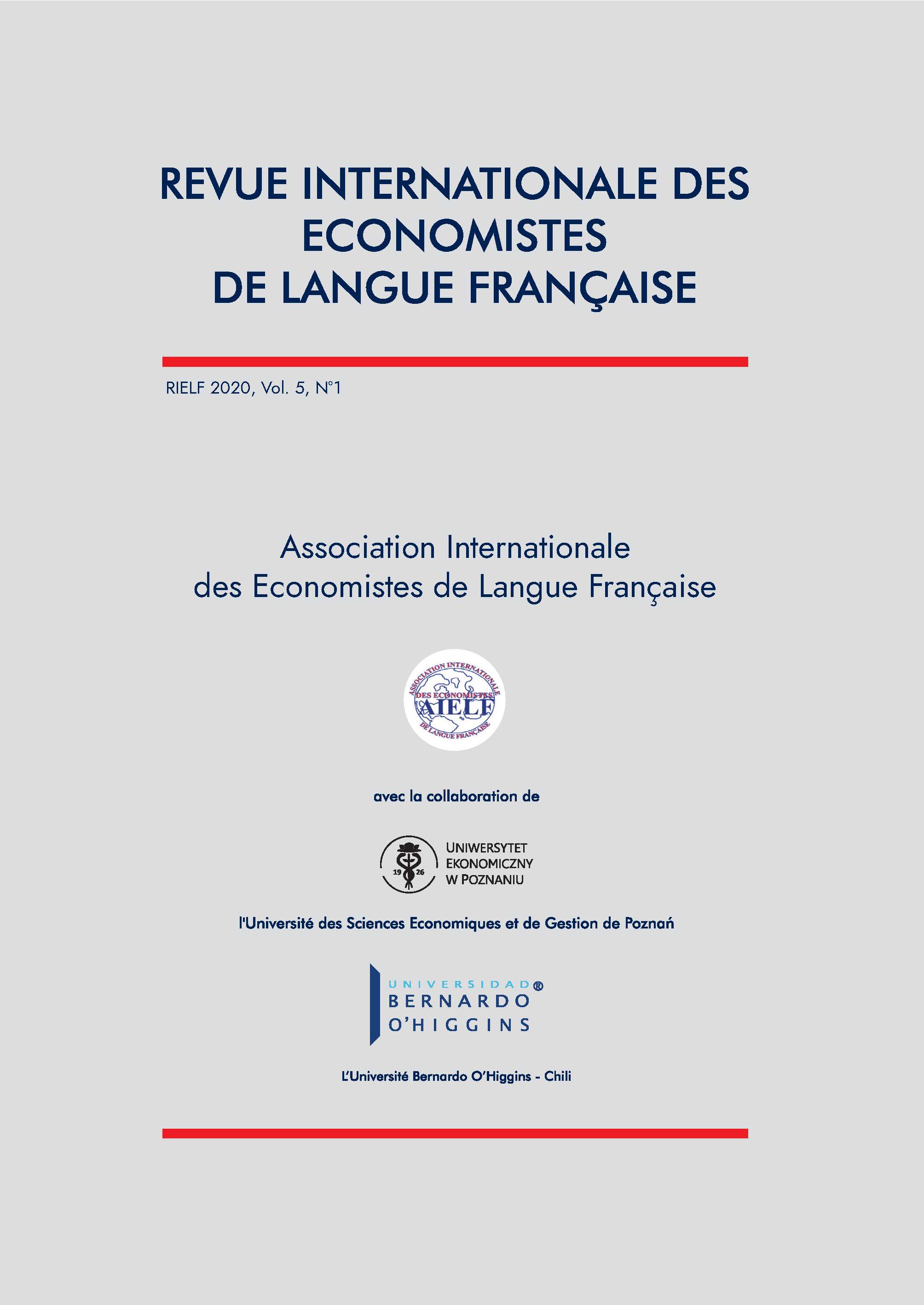
Vol. 5 No. 1 (2020)
Ce numéro 1 du volume 5 de la Revue Internationale des Economistes de Langue française est un volume varié constitué de 11 articles balayant un spectre très large de recherches tant théoriques qu’empiriques sur des domaines liés à la macroéconomie et à la microéconomie. Il a été réalisé sous la direction du professeur Jean-Christophe Poutineau de l’Université de Rennes 1, à l’invitation du rédacteur en chef Krzysztof Malaga, conformément aux principes éditoriaux du RIELF. La thématique en est très large puisqu’elle couvre des questions de macroéconomie monétaire, financière et réelle, d’économie bancaire, d’économie des ressources naturelles ainsi que des questions d’économie publique ou d’économie industrielle. De fait, de nombreuses questions d’actualité sont traitées à l’aide des développe- ments récents de l’analyse économique : la compréhension de la politique de taux d’intérêt négatifs de la BCE, la consolidation budgétaire des états européens, la précarité énergétique, le « shadow-banking », l’économie numérique, pour ne citer que quelques exemples. (Krzysztof Malaga)
-
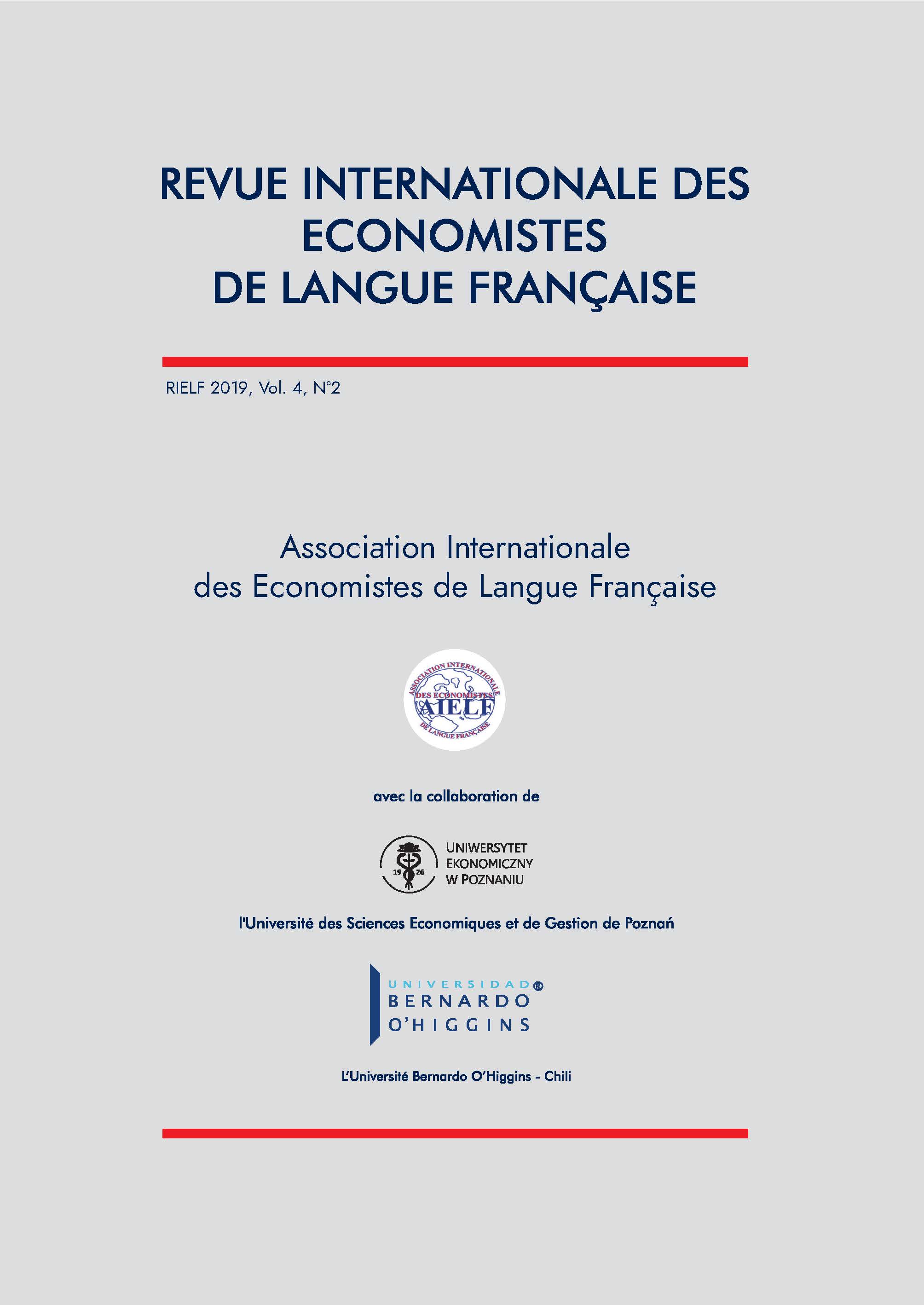
Vol. 4 No. 2 (2019)
Ce numéro 2019-2 de la RIELF est marqué par la présence de quelques articles ayant fait l’objet d’une présentation au Congrès de Santiago au mois de mai. Ils ont un lien avec des problèmes concernant l’Amérique Latine et les Antilles. Y figurent également une série de travaux à fort contenu empirique relatif le plus souvent aux pays sub-sahariens.
-
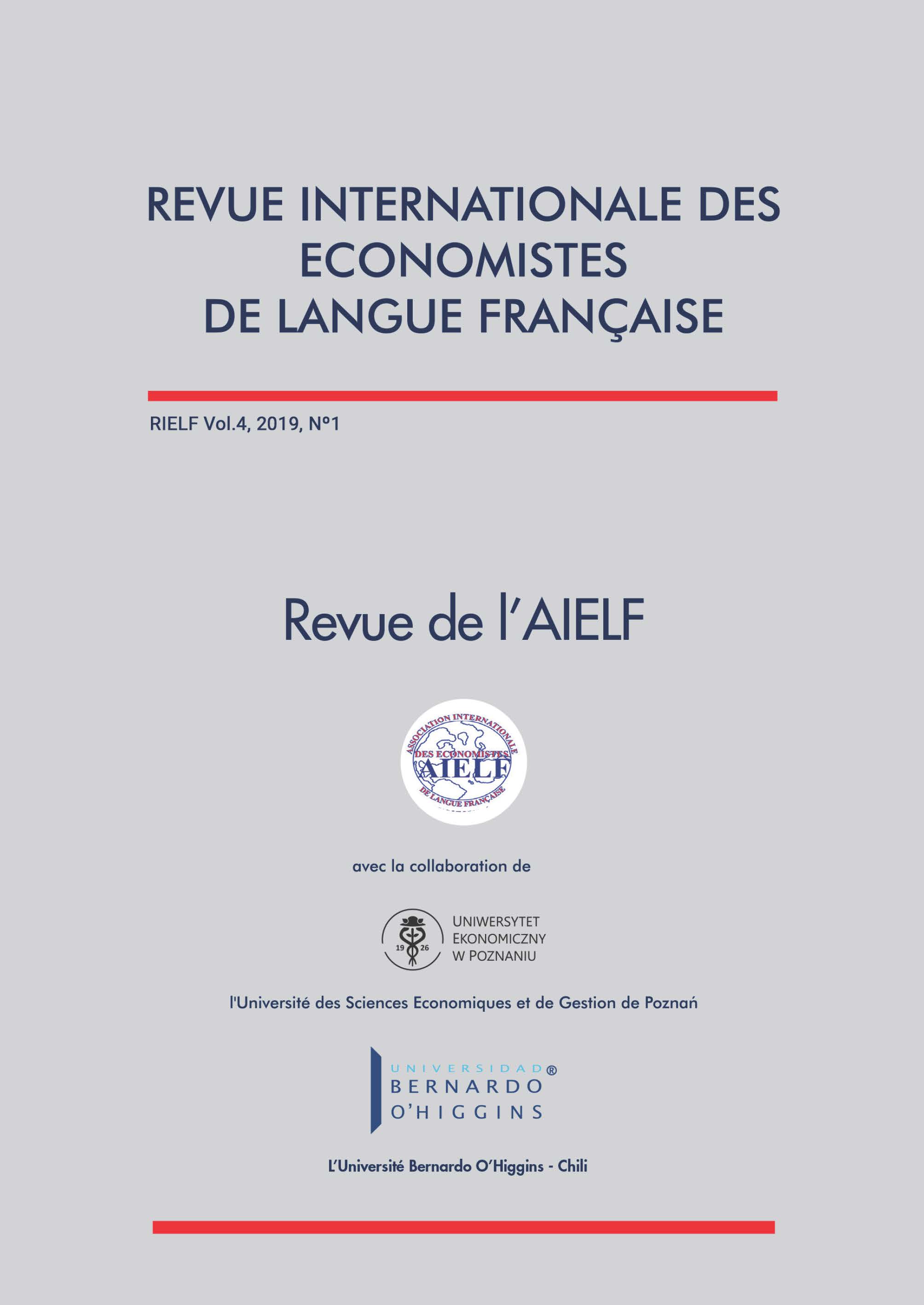
Vol. 4 No. 1 (2019)
L’essentiel de ce numéro spécial est consacré aux « Vingt ans de la Zone Euro », notre grand débat composé de très nombreux articles venant de nos adhérents de plusieurs pays. Les contributions sont classées en quatre catégories. Celles qui expriment comment cette aventure se place dans le processus d’intégration européenne ; celles qui tentent d’en faire un bilan, généralement critique ; celles qui s’attachent aux politiques économiques et aux projets de meilleure organisation de la Zone, notamment sur le plan de la solidarité financière ; celles enfin, écrites du point de vue des pays associés ou extérieurs à la Zone, qui effectuent des mises en perspective au plan mondial ou se posent des questions d’adhésion ou de retrait. On note l’importance et la qualité des contributions de Pologne, réunies par Krzysztof Malaga.
-

Vol. 3 No. 2 (2018)
Notre numéro 2018-2 se présente en deux parties à peu près équilibrées, l’une consacrée aux débats et l’autre comprenant les recherches. Les débats de ce semestre sont d’une part une amorce de réflexion quasi politique sur le fonctionnement de l’Union Européenne (un article) et d’autre part le grand débat international sur la croissance annoncé au précédent numéro, qui s’est avéré particulièrement fructueux (neuf articles). Les recherches publiées sont également en rapport avec la croissance (trois articles) ou d’orientations diverses (quatre articles).
-

Vol. 3 No. 1 (2018)
Pour la revue, ce numéro 2018-1 marque un tournant et trois nouveautés importantes sont à noter. En premier lieu, le passage à la forme numérique assortie de gratuité, qui devrait démultiplier de façon spectaculaire l’audience et le rayonnement de l’AIELF dans le monde francophone. En second lieu, la mise en place pour chaque livraison, d’un espace de débats permettant aux économistes de langue française de proposer des idées et des solutions à propos de grands problèmes économiques contemporains. En troisième lieu, l’Université Bernardo Higgins de Santiago du Chili et son Recteur Claudio Ruff Escobar nous offrent leur collaboration pour la revue et rejoignent ainsi le partenariat établi et confirmé à cet effet avec l’Université des Sciences Economiques et de Gestion de Poznań et Krzysztof Malaga.
Dans ce numéro, le débat inaugural est : « Pour un monde sans crise », où les auteurs, se plaçant du point de vue de leur spécialité, s’efforcent d’identifier les risques de crise économique et financière et de dégager des règles permettant de les réduire. Ce faisant, ils pratiquent de façon éminente ce que l’on peut qualifier de « sciences économiques efficaces », en référence au thème choisi pour notre futur congrès de Santiago du Chili en mai 2019. Loin des raisonnements stériles d’une recherche économique désincarnée et irréaliste, nos débats professionnels au sein de l’AIELF se tournent vers l’émission de messages discutables et forts que la revue s’efforce de transmettre au plus large public, aux étudiants et aux décideurs. Une recherche historique de notre collègue Francis Clavé nous apprend ci-dessous que c’est une préoccupation que l’Association AIELF a eue dès ses origines dans les années vingt et trente du vingtième siècle, les solutions retenues de nos jours restant ainsi dans sa continuité historique. D’autres débats suivront lors des numéros futurs et nous en annonçons deux à la suite de ce texte.
-
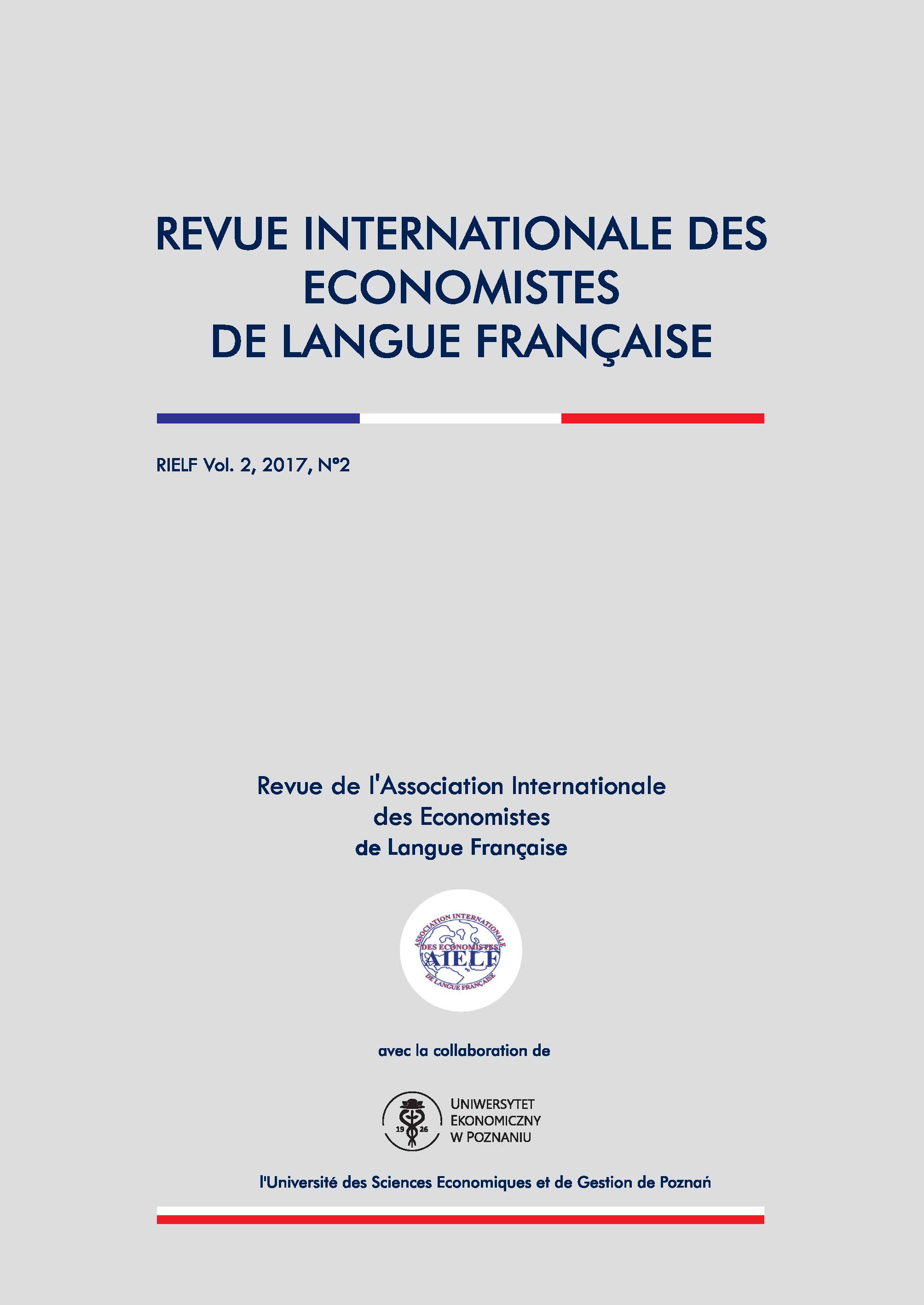
Vol. 2 No. 2 (2017)
Le présent numéro affiche clairement sa place dans le travail entrepris par l’AIELF pour une science économique pleinement universelle, par la variété des sujets abordés et des nationalités des auteurs. Il prend aussi la suite immédiate de nos travaux de Poznań, lors de notre congrès international du mois de mai 2017 et quelques articles sont des versions remodelées des communications de ce congrès particulèrement réussi. Mais encore, il a pour mission d’annoncer notre prochain congrès de 2019 dont le thème choisi, « efficacité de la recherche économique », est pleinement d’actualité. En effet, il n’est pas acquis que la science économique et les recherches qui l’alimentent jouent un rôle suffisant dans la réflexion sur l’avenir de nos sociétés et des économies. Il paraît donc nécessaire d’en examiner et d’en ré-appendre les « fondamentaux » avant de les adapter à leurs missions futures. Dans ce contexte, le recours à la pensée et à l’expression française est certainement l’un des chemins à suivre pour obtenir des idées fortes et leur transmission juste.
-
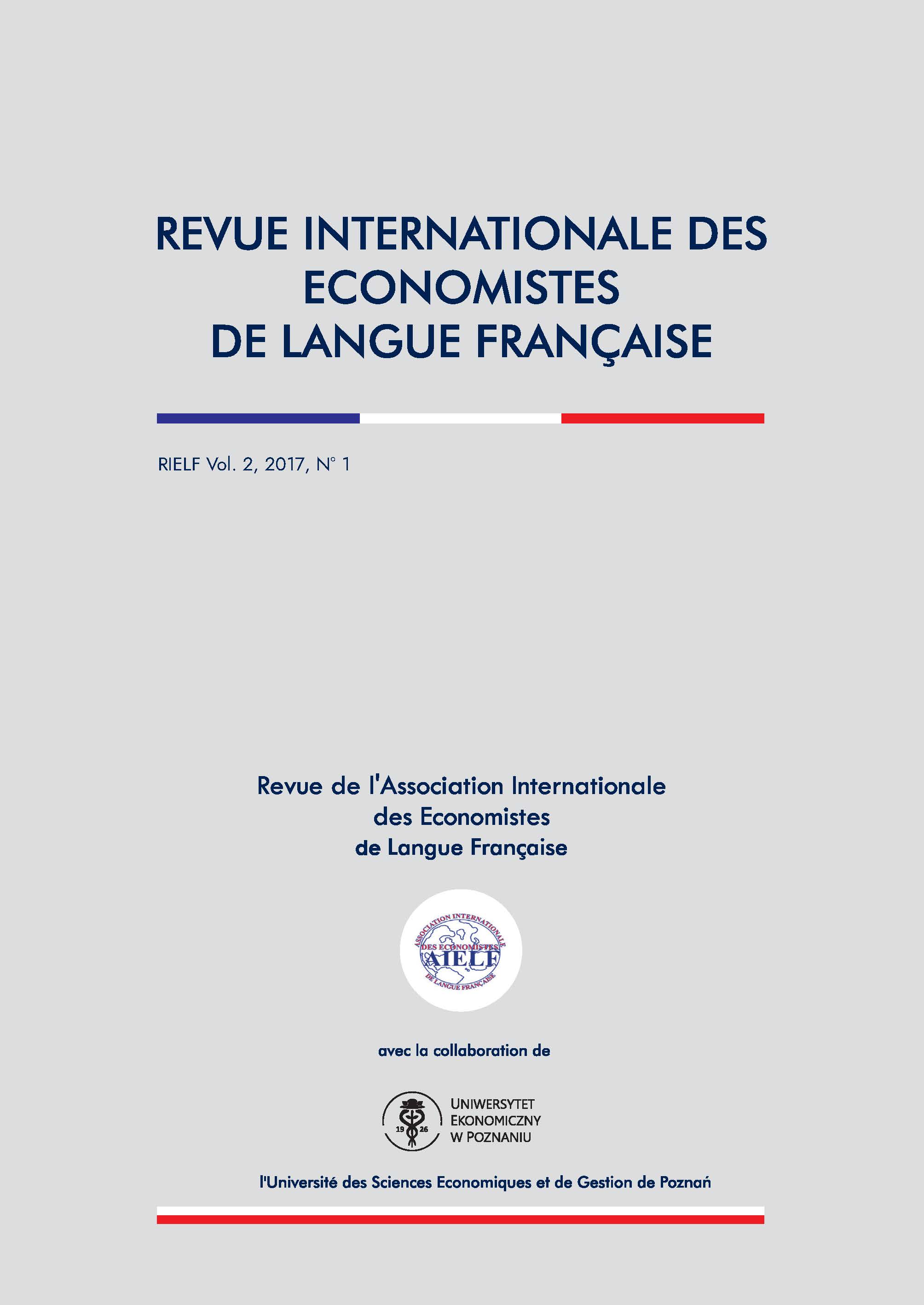
Vol. 2 No. 1 (2017)
Ce premier numéro pour 2017 est marqué par la prédominance de deux thèmes : d’une part les conditions de la croissance économique en Afrique sub-saharienne et d’autre part la politique monétaire et les problèmes de la zone euro.
La francophonie voit son centre de gravité se rapprocher progressivement de l’Afrique, du Maghreb à l’Afrique de l’Ouest et Centrale. Dans cette édition, c’est vers l’Afrique de l’Ouest que se sont tournés plus spécialement les regards des membres de l’Association. Cinq articles illustrent le thème des conditions de la croissance dans cette zone géographique :
« Les déterminants du développement des marchés boursiers en Afrique sub- saharienne » de Mamadou Konté, Mamadou Cissé, Jean-Jacques Birba et Thiernaud Behanzin s’est fixé pour objectif de rechercher les déterminants du développement des marchés boursiers en Afrique subsaharienne. A cette fin, neuf marchés boursiers de la région ont été étudiés et la capitalisation boursière en pourcentage du PIB a été utilisée comme indicateur de développement du marché boursier. Les résultats ont révélé que le taux de croissance économique, la capitalisation boursière retardée d’une période, la monétarisation, le taux d’inflation, le taux de rotation du marché boursier et le degré d’ouverture commerciale sont les déterminants du développement des marchés boursiers en Afrique subsaharienne. L’article a aussi montré l’imbrication mutuelle étroite de la croissance économique avec les marchés boursier et bancaire.
« Régime de changes et performances économiques en Afrique : Quelles leçons pour les pays de l’UEMOA ? » d’Abdoul Khadry Sall cherche à évaluer l’influence du régime de change sur les performances macroéconomiques afin d’en tirer des leçons pour les pays de l’UEMOA où la politique de change fixe caractérise le régime monétaire. Pour cela, une estimation en données de panel a été adoptée et effectuée sur 32 pays pour évaluer l’impact du régime de change sur les perfor- mances macroéconomiques pendant la période 1980-2010. L’auteur conclut que la croissance dans les pays en régime de change fixe est plus faible que celle dans l’ensemble des pays en régime de change intermédiaire. Quant au coefficient associé au régime de change flexible, il traduit que les pays en régime de change flexible pourraient avoir des taux de croissance plus élevés que les pays en régime de change intermédiaire. L’implication à tirer pour les pays de l’UEMOA est que la recherche d’un point d’ancrage nominal domestique permettrait le maintien de l’inflation à des niveaux faibles et stables tout en améliorant les performances de croissance.
-
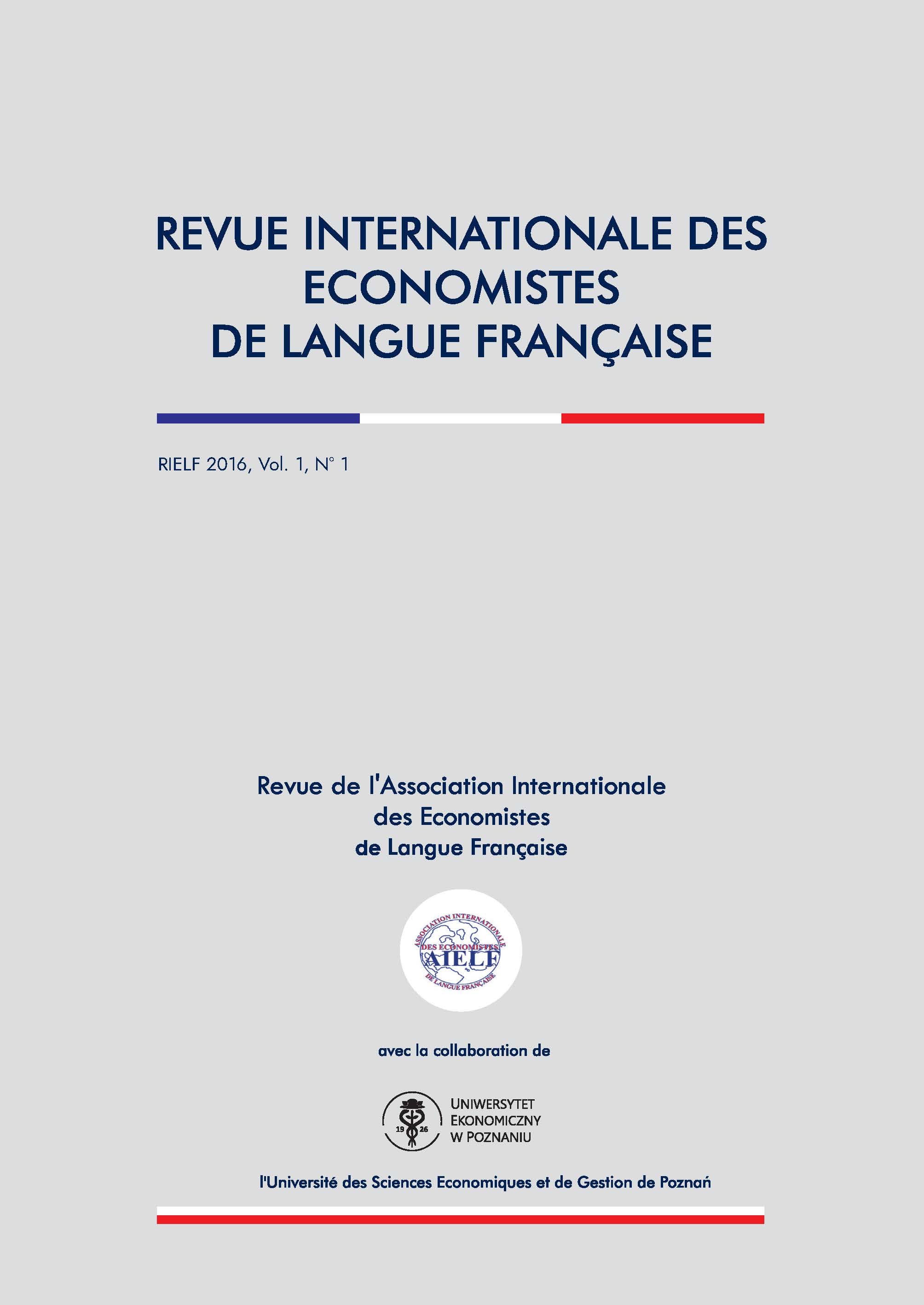
Vol. 1 No. 1 (2016)
Les articles de ce numéro inaugural tournent autour de quelques thèmes principaux que nous égrenons dans l’ordre : politique économique, croissance et emploi, économie mondiale, théorie microéconomique et Union européenne. Un texte sur le nouveau système comptable clôt le numéro.
Dans son texte « L’impact du risque individuel dans l’explication des écarts de taux d’intérêt au sein de la zone euro », Guillaume L’OEillet revient sur l’épisode inédit de divergence des taux d’intérêt sur la dette publique au sein de la zone euro entre 2008 et 2012. Ce phénomène a révélé une certaine hétérogénéité de l’UEM.
A partir d’une revue de la littérature et d’une analyse empirique, l’auteur démontre que les facteurs spécifi ques jouent un rôle crucial dans l’explication des écarts de taux d’intérêt. L’insoutenabilité des fi nances publiques et une compétitivité dégradée semblent justifi er l’envolée des taux obligataires pendant la crise.
La persistance de la crise économique et fi nancière actuelle en Grèce enseigne que la combinaison d’une augmentation du taux d’imposition avec des mesures d’austérité dans les périodes de récession engendre un cercle vicieux où s’enchaînent diminution des recettes fi scales, baisse du produit intérieur brut et augmentation du rapport dette public sur le PIB. Ce mécanisme est connu sous l’appellation de trappe à fi scalité. Dans le texte intitulé « Piège à fi scalité : le cas de l’économie gabonaise », Médard Mengué Bidzo vérifi e empiriquement, en employant la Méthode des Moments Généralisés en système (MMG), que l’économie du Gabon est déjà prise à ce piège.